Macron et Lecornu : le peuple accusé, la crise s’aggrave

Macron et Lecornu sont au cœur d’une séquence politique explosive. Après des semaines d’imbroglio institutionnel et de tractations, un gouvernement tombé en quelques heures et une défiance record, l’exécutif cherche encore des responsables. Le récit officiel est connu : le pays serait devenu ingouvernable, le débat irrationnel, la rue « excessive ». Mais un constat s’impose : si la crise s’aggrave, ce n’est pas parce que le peuple gronde. C’est parce que la gouvernance patine, et que les réponses n’arrivent plus.
Macron et Lecornu face au mur : récit d’un affaiblissement
La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon devait réamorcer la machine. Son profil de gestionnaire promettait de retrouver une stabilité politique perdue. En pratique, les « obscures négociations » ont accouché d’un gouvernement éphémère, renversé en une quinzaine d’heures. Un record qui symbolise l’impuissance du pouvoir à rassembler. Macron et Lecornu défendent la même ligne : réformer vite, communiquer fort, tenir bon. Mais l’adhésion ne suit pas. Les marqueurs d’usure s’accumulent : majorité technique, climat social crispé, opposition fragmentée mais offensive.
Dans l’opinion, la lassitude domine. Les Français ont le sentiment d’assister à une succession de coups tactiques sans cap stratégique. Chaque crise est traitée comme un épisode médiatique, rarement comme un problème politique de fond. Résultat : le crédit d’action se réduit, et l’exécutif paraît gouverner sous contrainte permanente.
Un système à bout de souffle
La Ve République a été pensée pour la stabilité. Or, le fonctionnement actuel en montre les limites : exécutif isolé, Parlement fragmenté, corps intermédiaires méfiants. L’hyper-présidentialisation accentue l’effet tunnel : quand la confiance chute, l’ensemble de l’architecture tremble. Les épisodes successifs – remaniements, discours d’autorité, arbitrages opaques – n’inversent plus la courbe. Ils nourrissent l’idée d’un système verrouillé qui peine à produire du consensus.
Ce n’est pas seulement une crise de personnes. C’est une crise de méthode. Les réformes sont présentées comme inéluctables, la concertation vécue comme un obstacle, le dissensus assimilé à de l’irrationalité. En retour, la société s’arc-boute, et la colère prend le pas sur l’adhésion.
Le grand renversement rhétorique : le peuple coupable idéal
Quand la mécanique se grippe, la tentation est forte de déplacer le centre de gravité du problème. On accuse la « radicalité » du débat, la « violence » des réseaux, l’« hystérisation » médiatique. On parle d’une France « ingouvernable ». Cette narration dédouane l’exécutif et dépolitise les désaccords. Elle transforme la contestation en pathologie, au lieu de la considérer comme un signal démocratique.
Le résultat, c’est un décalage croissant entre le pays réel et le pays institutionnel. Inflation ressentie, services publics à cran, fiscalité jugée instable, territoires oubliés : autant de faits têtus. Les qualifier de « climat » ou de « perception » ne les fait pas disparaître. Et lorsque le discours officiel semble nier l’expérience vécue, la confiance se brise.
Macron et Lecornu, mêmes contraintes, mêmes impasses
Le duo à la tête de l’exécutif affronte une équation sans solution facile : un Parlement sans majorité claire, une pression budgétaire, une défiance à l’égard des corps intermédiaires, un agenda européen exigeant. Macron et Lecornu répondent par une posture d’efficacité : imposer le tempo, afficher la fermeté, verrouiller la feuille de route. Mais cette grammaire de la verticalité fonctionne mal dans un pays fracturé. Sans coalition stable, le passage en force devient tentation ; or chaque passage en force coûte plus cher politiquement que le précédent.
Le court-termisme guette : annonces calibrées, séquences médiatiques, arbitrages tardifs. À force d’être réactif, on n’est plus stratégique. La politique ressemble à une gestion de flux – crises, polémiques, correctifs – plutôt qu’à une construction de trajectoire lisible.
La tentation du sécuritaire et de la régulation de la parole
Dans un paysage fragmenté, la réponse privilégiée est souvent la régulation – de la rue, des usages, de la parole. L’arsenal sécuritaire s’épaissit, les incriminations s’étendent, les conditions d’expression se resserrent, au nom de la protection de l’ordre public et de la lutte contre la manipulation. Cette logique peut rassurer une partie de l’électorat, mais elle a un coût : elle entame la confiance civique et alimente le procès en « démocratie sous cloche ».
Dans le même esprit, la régulation numérique européenne, justifiée par la lutte contre la désinformation, est perçue par d’autres comme un filtre politique de plus. Le débat devient binaire : pour ou contre la « raison ». Sauf qu’une démocratie vivante assume la conflictualité des intérêts et la pluralité des récits, sans chercher à l’éteindre par décret.
Oppositions éclatées, centre sous tension : la scène parlementaire introuvable
La gauche hésite entre coalitions électorales et divergences programmatiques. La droite alterne coups d’éclat identitaires et souci de respectabilité. Le centre, lui, demeure recomposé autour de l’exécutif, sans fond doctrinal unifié. Dans cet entre-deux permanent, les majorités d’idées sont rares, et l’arbitrage retombe sur l’Élysée. C’est l’impasse : sans architecture de compromis, la négociation devient suspicion, et chaque vote se transforme en test de survie gouvernementale.
Ce manque de lisibilité nourrit l’abstention et la défiance. Les citoyens n’identifient plus qui propose quoi, ni comment se construit une décision nationale. La pédagogie démocratique est la grande absente de la période.
Le prix social de l’instabilité
La politique ne se joue pas qu’à l’Assemblée. Elle se vit dans les hôpitaux surchargés, les écoles en tension, les transports sous-dotés, les territoires enclavés. L’instabilité institutionnelle a un coût social tangible : reports de décisions, incertitude réglementaire, investissements retenus, fatigue des équipes publiques. Les agents comme les usagers expérimentent une friction quotidienne qui s’accumule. Quand l’État paraît hésiter, tout le système ralentit.
Cette friction alimente la colère. Non pas une colère abstraite, mais une colère située : devant un guichet, dans une salle d’attente, à la caisse d’un supermarché. À force, l’exécutif est jugé non sur ses promesses mais sur la qualité de l’ordinaire.
Macron et Lecornu doivent-ils changer de méthode ?
La question centrale n’est pas : dissolution ou pas ? Elle est : comment retisser un contrat de confiance ? Tant que la conduite des politiques publiques restera verticale et que la conflictualité sociale sera traitée comme un bug, la mécanique s’enrayera. Inversement, une méthode qui assume le compromis, qui stabilise les règles du jeu fiscal et réglementaire, qui redonne des marges d’action locales, peut recréer des appuis.
De nombreuses démocraties parlementaires – y compris dans l’Union européenne – ont su inventer des coalitions de projet et des accords de législature. La France peut s’en inspirer sans renoncer à ses institutions, comme le rappelle l’histoire de la Cinquième République : l’outil n’est pas le problème, c’est l’usage qui en est fait.
Le rôle des citoyens : reprendre part au récit national
Face à l’épuisement, la sortie par le haut passe aussi par la société civile : syndicats, associations, médias indépendants, collectifs d’élus locaux. Ces acteurs peuvent remettre du réel dans le débat et imposer des agendas concrets : hôpital, école, sécurité du quotidien, pouvoir d’achat, transition énergétique pragmatique. La démocratie ne se réduit pas aux institutions ; elle se nourrit des initiatives venues d’en bas.
Cette dynamique suppose d’ouvrir l’information, de respecter la contradiction, et de considérer la contestation comme une ressource démocratique, pas comme un péril. À cette condition, le pays peut retrouver une boussole.
FAQ
Pourquoi parle-t-on d’un renversement de responsabilités ?
Parce que le discours officiel attribue la crise à la « radicalité » du débat public, quand beaucoup y voient d’abord un problème de méthode et d’isolement de l’exécutif.
Quel est l’enjeu pour Macron et Lecornu ?
Construire des majorités durables et lisibles, stabiliser la règle du jeu, et renouer avec une pratique du compromis qui donne des résultats visibles dans la vie quotidienne.
Le système institutionnel est-il en cause ?
Les institutions accentuent certains effets (verticalité, personnalisation) mais n’imposent pas l’impasse. D’autres pratiques de négociation et d’évaluation sont possibles dans ce cadre.
Que peut faire le citoyen ?
Se saisir des débats, soutenir les médias indépendants, interpeller ses représentants, et agir via des campagnes civiques – par exemple en soutenant cette pétition pour plus d’exemplarité publique.
Comment sortir de l’ère du passage en force ?
En privilégiant des accords de méthode au Parlement, en fixant des objectifs évaluables, en publiant des bilans réguliers, et en associant les territoires aux décisions qui les concernent.
Conclusion : Macron et Lecornu, miroir d’une démocratie en tension
Au terme de cette séquence, une évidence : Macron et Lecornu n’ont pas face à eux un peuple « coupable », mais un pays exigeant. Exigeant sur la clarté, la stabilité, la justice et l’efficacité. La crise actuelle n’est pas un accident ; c’est le résultat d’une politique trop verticale dans une société devenue horizontale. Continuer à gouverner « contre » ne fera qu’aggraver l’usure. Gouverner « avec », en revanche, suppose d’accepter la pluralité et la négociation, et de produire des résultats tangibles dans l’ordinaire des Français.
Le pouvoir peut y voir une contrainte. C’est en réalité une chance : celle de retisser un contrat civique. Le jour où le débat s’ouvrira vraiment, la crise cessera d’être un gouffre pour redevenir un passage.
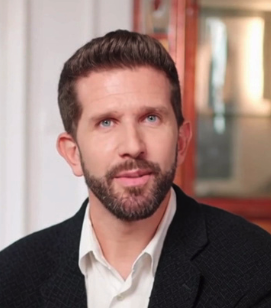
Stéphane Richard
Le 12/10/2025